1823 – Imprimerie Royale (première édition)
2007 – Gallimard – Disponible en poche
 M. le chevalier de B. alors gouverneur du Sénégal achète la petite Ourika, 2 ans pour la sauver du négrier qui l’emmenait aux Amériques. Il la ramène à Paris et l’offre à sa tante, Madame de B.
M. le chevalier de B. alors gouverneur du Sénégal achète la petite Ourika, 2 ans pour la sauver du négrier qui l’emmenait aux Amériques. Il la ramène à Paris et l’offre à sa tante, Madame de B.
Ourika arrive en France quelques années avant la Révolution quand les idées des Lumières et pensées abolitionnistes commencent à se répandre. Ourika est éduquée, formée, parfaitement adaptée et intégrée à la bonne société. Elle est aussi montrée, sans méchanceté, comme sujet exotique : sa peau noire et ses origines excitent chez les amies de Madame de B. une curiosité empreinte de racisme. Ce n’est pas le cas de Madame de B. qui cherche plus à appréhender des cultures qui lui sont étrangères et à sensibiliser Ourika sur son héritage culturel.
Madame de Duras mêle habilement la notion de classe sociale à celle de la couleur de peau. En effet, c’est une des amies de Madame de B. qui au cours d’une discussion lui signifie qu’Ourika, à cause de sa couleur de peau, ne pourra jamais accéder au rang social auquel sa tutrice la prépare. Ourika surprend l’entretien et se perçoit dès lors de couleur noire et de classe sociale inférieure. À compter de cette double prise de conscience, Ourika va sombrer dans la mélancolie. Elle sait qu’elle ne pourra pas trouver de place dans la société de Madame de B., société sophistiquée et bourgeoise ; ni trouver de place dans la société « d’où elle vient », qu’on lui a décrit comme sauvage et non civilisée. Elle ressemble à Edmond Albius « trop noir pour les Blancs, trop blanchi pour les Noirs » (La vraie couleur de la vanille, Sophie Chérer, École des Loisirs). La mécanique d’exclusion est en marche, la fatalité de sa condition a pris le dessus sur sa personne. Percluse par la peur de n’être jamais différenciée de sa couleur, honteuse de ce qu’elle est et de ce qu’elle ressent, elle tait son chagrin. Autour d’elle, Madame de B. et son petit-fils Charles ne peuvent pas imaginer les troubles qui la traversent. Ils sont sa famille, ils ne voient pas Ourika comme une petite négresse rapportée du Sénégal mais bien comme un membre à part entière de leur famille.
Pour justifier la profonde mélancolie d’Ourika, on va lui prêter un sentiment amoureux pour Charles. Ourika s’en contentera également pour expliquer ce chagrin qui la dévore. La critique à la parution du roman en 1823 admettait cette lecture et qualifiait le roman de sentimental. Néanmoins, le propos de l’écrivain est plus politique. D’abord parce que c’est Ourika qui parle. Elle à qui on a dit toute sa vie, ce qu’elle était, qui elle aimait, ce qu’elle ne pourrait jamais être, raconte sa propre vie. Ce roman est d’ailleurs considéré comme le premier de la littérature française à avoir pour personnage central une personne Noire. Ensuite parce qu’en plongeant dans la description des sentiments d’Ourika face à l’exclusion, Madame de Duras trace le portrait d’une société qui organise ses inégalités sociales par la classe, par la couleur, par le sexe et dont les mécanismes d’exclusion abîment les individus en les condamnant à une solitude terrible, un sentiment de rejet tel qu’il leur est difficile, presque impossible, de constituer leur propre identité, au-delà de leur appartenance sociale ou raciale.
Claire de Kersaint naît en 1777 en France et y décède en 1828. Contrainte à l’exil suite à la mort de son père, guillotiné en 1793 pour avoir refusé de voter la mort du roi Louis XVI, elle se rend d’abord en Martinique d’où sa mère est originaire puis à Londres où elle épouse le duc de Duras. À son retour à Paris en 1808, elle se lie d’amitié avec Chateaubriand qui lui ouvre les portes du monde littéraire. Elle tient un des plus important salon de Paris réunissant des scientifiques, des écrivains et des hommes politiques. Cédant aux arguments et pressions de Chateaubriand, elle finira par accepter de faire publier anonymement en 1824 « Ourika » pour se protéger du plagiat. Ses autres romans « Édouard », « Olivier ou le Secret » ne seront édités qu’en 1971 et « Les mémoires de Sophie » et « Amélie et Pauline » le seront en 2011. Éminemment moderne, Madame de Duras explore dans ses romans les questions de l’identité, de la sexualité, de l’exclusion, de l’émigration.

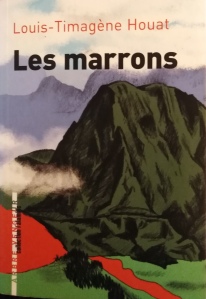
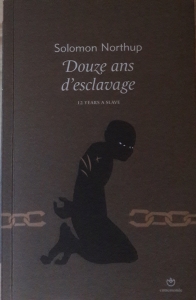 États-Unis, 1841. Solomon Northup est né et a grandi dans l’État de New York. Homme libre, il va être capturé par deux négriers et vendu comme esclave en Louisiane. À l’issue de sa libération douze ans plus tard, Solomon Northup écrira avec l’aide d’un juriste le récit de ces douze années d’esclavage.
États-Unis, 1841. Solomon Northup est né et a grandi dans l’État de New York. Homme libre, il va être capturé par deux négriers et vendu comme esclave en Louisiane. À l’issue de sa libération douze ans plus tard, Solomon Northup écrira avec l’aide d’un juriste le récit de ces douze années d’esclavage.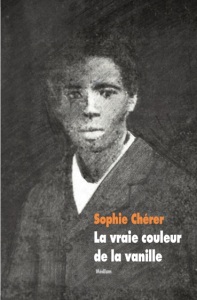
 Chercher une femme dans les rues de Lisbonne en ne connaissant d’elle que sa voix et son prénom, pas de doute, Jean-Yves Loude n’est pas un imposteur : Lisbonne lui a soufflé les secrets de son âme. Très vite, l’intrigue romanesque se mue en récit et c’est l’histoire de la présence africaine que l’auteur va nous raconter. Sous les pavés de Lisbonne, le Cap-Vert, l’Angola, la Guinée, le Mozambique, São Tomé-et-Príncipe.
Chercher une femme dans les rues de Lisbonne en ne connaissant d’elle que sa voix et son prénom, pas de doute, Jean-Yves Loude n’est pas un imposteur : Lisbonne lui a soufflé les secrets de son âme. Très vite, l’intrigue romanesque se mue en récit et c’est l’histoire de la présence africaine que l’auteur va nous raconter. Sous les pavés de Lisbonne, le Cap-Vert, l’Angola, la Guinée, le Mozambique, São Tomé-et-Príncipe.