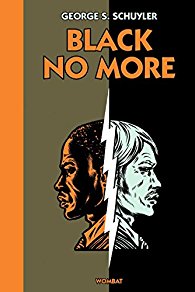Éditions Payot & Rivages, 2009 (pour la traduction française) – Disponible en poche
Bourgeois blues – 1991 – Jake Lamar
Traduit de l’anglais (USA) par Françoise Bouillot
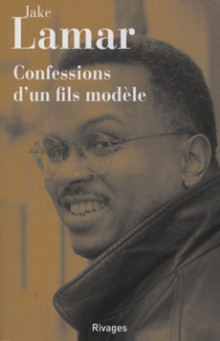
Etats-Unis, dans les années 80. Au son de Thelonious Monk, Jake Lamar raconte sa relation avec son père et à travers elle, une histoire de la bourgeoisie Noire-Américaine.
Récit autobiographique, Confessions d’un fils modèle se lit comme un roman ou comme un essai. Si le titre français se concentre sur le cercle familial, le titre original « Bourgeois blues » ouvre plus largement sur un phénomène de classe.
Jake Lamar s’appelle comme son père, qui s’appelait déjà comme son père. Cette homonymie, c’est dès le berceau un héritage qu’il faudrait porter en identité et un modèle à honorer. Dans son livre, Jake Lamar va raconter son père. Pour tenter de le comprendre, de se comprendre et de prendre du recul, il va passer du modèle au portrait. Le père raconté par le fils, c’est le portrait d’un homme acharné : dans ses colères, dans ses désirs, dans son travail. Il est le fruit d’une génération où les Noirs-Américains pouvaient s’extraire de leur condition et réclamer leur dû au pays de la réussite individuelle. Jake Lamar (père) travaille brillamment, ne laisse rien au hasard, intègre la faculté de Morehouse. Morehouse, c’est cette faculté située à Atlanta créée afin de donner aux Noirs la même éducation que les Blancs, dressant ainsi une arme puissante contre la ségrégation : former une élite et une bourgeoisie Noire-Américaine. La réussite individuelle devient alors sociale, politique et militante. Frein ou moteur, la réussite à travers les diktats d’une classe sociale éloigne de soi. En fréquentant la même faculté que Martin Luther King et en en sortant major de sa promotion, Jake Lamar (père) intègre la classe bourgeoise Noire-Américaine et obéit alors à ce qu’il doit devenir. Il se marie, fait des enfants, travaille énormément, pique des colères homériques et décharge ce poids permanent de l’homme Noir qui doit prouver sa légitimité en se sentant toujours en imposture sur son fils aîné Jake Lamar.
Jake Lamar (fils) fait partie de la première génération de Noirs-Américains qui va pouvoir grandir dans une presque insouciance. Né en 1961, on va lui expliquer, à la maison comme à l’école, que les Noirs et les Blancs sont égaux, qu’ils ont accès aux mêmes choses. L’insouciance vis-à-vis de sa couleur de peau ne durera évidemment pas longtemps, l’Amérique ne s’est pas endormie ségrégationniste pour se réveiller égalitaire. Néanmoins, dans la perception de Jake Lamar, les différences établies sur ce simple critère qu’est la couleur de peau raisonneront toujours comme une injustice et un signe de stupidité. Ce n’est plus une fatalité ou un état de fait. Ce n’est plus un combat dont on questionne la légitimité.
L’héritage du père, et à travers lui l’héritage de la génération précédente et l’héritage de sa classe résonne comme une malédiction, comme le dragon qu’il faut combattre pour passer de l’enfant, ou plutôt de l’adolescent, à l’adulte.
L’insouciance des toutes premières années de Jake Lamar, son éducation et ce père écrasant le pousseront à repenser les stigmates des générations passées et à refuser les conditionnements de sa génération. Ce père en colère, qui lui fait peur, qui est aussi brillant qu’il est arrogant, aussi misérable qu’il est à plaindre, est un pur produit de sa génération et de sa classe. Et à travers ce récit, Jake Lamar refuse d’être un produit de sa génération, ou du moins de n’être que cela, en constituant d’autres bulles que celle où il est un homme Noir, que celle où il est enfant de parents divorcés, que celle où il est le fils d’un père violent, que celle où il est le fils d’un homme autant fier qu’honteux d’être noir de peau.
Récit autobiographique, ce livre est aussi un ouvrage de sociologie, de psychologie et un roman d’extraction. Comment s’extraie-t-on du déterminisme social, de nos héritages symboliques et historiques ? Comment s’extraie-t-on du mythe de l’identité ? Pas de réponses ni de certitudes sous la plume de Jake Lamar, des possibles, des chemins, sans oublier Thelonious Monk et la littérature en compagnons de voyages.
Jake Lamar est né en 1961 à New-York. Écrivain et journaliste, il aura longtemps travaillé pour le Times avant de venir s’installer à Paris en 1993 où il commencera à écrire des romans. Il y découvrira aussi les romans de Chester Himes. Il est notamment l’auteur de « The last Integrationist » (« Nous avions un rêve » – 1996), « If 6 Were 9: A « Militant » Mystery » (Le Caméléon noir – 2001) et « Ghosts of Saint-Michel » ( » Les Fantômes de Saint-Michel » – 2009) tous publiés et traduits chez Payot-Rivages.